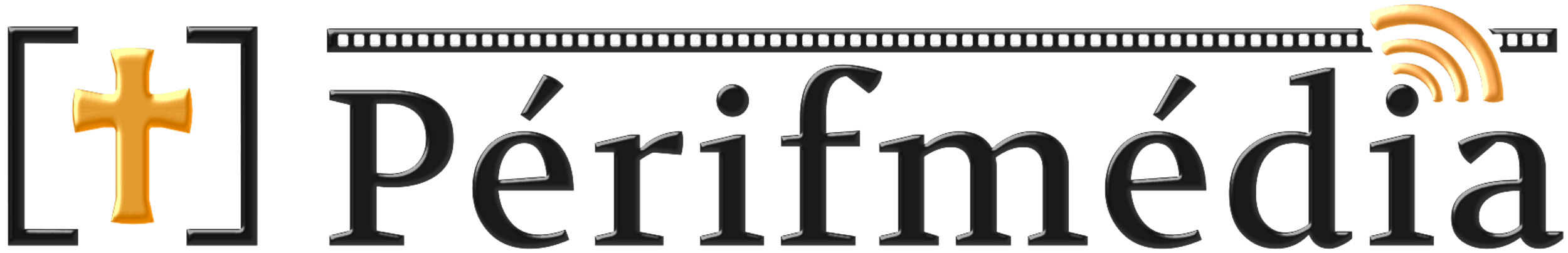La Croisée des chemins
....
De cape et d’épée
“Tous pour un! Un pour tous!” Telle était la devise des trois Mousquetaires qui, en fait, étaient quatre: Athos, Portos, Aramis et d’Artagnan.
Ces premiers mots donnent une idée du fonctionnement de ma mémoire, et même de ma réflexion. Après avoir témoigné, dans un premier chapitre, du fait que la découverte de la complémentarité de l’Un et du Multiple était fondamentale dans mon cheminement philosophique vers la Trinité, c’est cette devise qui me vient à l’esprit pour entreprendre le second. Quel est le rapport?
Des amis m’ont surnommée avec humour «la fille aux liens» parce que, dans une discussion, j’interviens souvent en faisant des liens de ce genre, des liens déroutants qui peuvent à l’occasion être «forcés», je l’avoue. Mais il arrive que certains d’entre eux mettent en rapport des éléments auxquels on n’avait pas pensé jusque-là, simplement parce qu’on ne s’était pas encore placé sous cet angle particulier.
Ainsi donc, cette devise des Mousquetaires me vient à l’esprit. Elle me rappelle de longues heures de lecture. Eh oui! Si j’ai rarement lu des ouvrages de philosophie d’un couvert à l’autre, j’ai par contre lu un certain nombre de romans jusqu’au bout, et relu quelques-uns d’entre eux plusieurs fois.
Dans ma prime adolescence, ma préférence allait aux histoires de cape et d’épée. Celle des Mousquetaires d’Alexandre Dumas père, notamment, tient une place à part dans mes souvenirs, parce qu’elle compose avec ce qu’on appelle la grande Histoire. Le récit met en scène des personnages qui ont marqué l’Histoire de France au XVIIe siècle. Les quatre Héros eux-mêmes s’inspirent de personnes qui ont existé, porté les mêmes noms et furent effectivement Mousquetaires du Roi.
Ce fond de réalité était sans doute ce qui me subjuguait le plus. Il me faisait rêver. Serait-il possible que je puisse moi-même vivre quelque chose de semblable, que mon existence soit toute entière investie dans une cause de grande valeur?
Alors que les Mousquetaires étaient chargés de missions secrètes au service de sa Majesté, un autre parti complotait - littéralement sous cape - pour porter atteinte à la Couronne, et l'on suivait, tout au long du récit, les péripéties d’un duel entre ces deux camps.
Fille de soldat, j’avais le goût de participer à de tels combats, «afin que le bon droit triomphe!» Ce qui ne veut pas dire que j’étais nécessairement brave.
Coeur qui soupire
Captivée que j’étais par les romans de genre épique, j’en dévorais donc aisément toutes les pages. Lorsque j’atteignais la dernière ligne d’un récit, je refermais le livre à contrecœur. Et je soupirais. Souvent, je le feuilletais à nouveau, m’arrêtant aux passages que j’avais goûtés de façon particulière, comme si je voulais retarder au maximum le moment où je “retomberais” dans le courant de la vie. Je savais bien que cet univers romanesque n’était pas réel et que, s’il me fournissait des heures d’enthousiasme, celui-ci était éphémère. Un moment de distraction.
Durant les étés désœuvrés de mon adolescence, peu encline aux jeux du dehors, je m’installais aussi volontiers devant le téléviseur pour visionner les films d’aventures que l’on présentait en après-midi ou en soirée. Et de soupirer encore, la dernière image passée. J’étais décidément portée à l’ennui.
Dans ma réalité au jour le jour, il me semblait vivre comme partagée entre deux mondes. Il y avait d’abord le monde de la foi dans lequel j’avais été heureusement introduite dès l’enfance par mes parents, notamment à travers la bonté de mon père et la sagesse de ma mère. Ce monde s’estompait quelque peu, mais il m’attirait toujours irrésistiblement en un endroit de mon être qui demeurait scellé. Et il y avait cet autre monde tout autour, agité, actuel, réseau de relations humaines enchevêtrées, palpitant de quêtes et de causes diverses souvent contradictoires, dans lequel j’essayais de m’insérer, car il fallait, disait-on, passer par là.
Entre-temps, je vivais dans le tiers-monde de mon quotidien, selon ma routine habituelle, poursuivant mes activités avec ce dilettantisme et cette nonchalance que l’on retrouve souvent chez les ados. Il m’arrivait, de temps en temps, d’avoir la désagréable impression d’être entraînée dans des ornières où tant d’autres avant moi avaient marché. Une petite nausée volatile me venait aussi parfois, mais je n’osais pas formuler ce qu’elle exprimait. «À quoi bon», me suggérait-elle.
Par ailleurs, je me savais gâtée par la vie. Je pouvais compter sur un bon milieu familial et les réussites scolaires se succédaient, année après année. On aurait pu dire que l’avenir me souriait. Pourtant cela ne me suffisait pas, ne pouvait suffire. Je soupirais toujours, espérant quelque éclair fulgurant qui m’aurait fait enfin découvrir le pourquoi (et le pour-quoi) de mon existence.
Et je m’inquiétais un peu. La réponse répondrait-elle à mes attentes?
En tout cas, je ne pouvais me résigner à ce qu’il n’y ait pas de réponse, ou que ma vie soit le simple fruit d’un Hasard ou d’une Nécessité, enfermée dans quelque cycle sans âme.
Le vague à l’âme
À ce moment-ci, quelqu’un pourrait se demander si je ne me suis pas égarée sur un chemin de traverse, entraînée par le souvenir de mes jeunes états d’âme. Qu’est-ce que tout cela a à voir avec un cheminement philosophique vers la Trinité?
Tout!
Je crois que les philosophes ont tous plus ou moins ressenti ce que le XIXe siècle a appelé le vague à l’âme, qui correspond à l’expérience concrète que beaucoup d’entre nous peuvent faire à différents âges de la vie, surtout en cet âge qui précède l’âge adulte.
Dans «Génie du christianisme», François-René de Chateaubriand le décrit de la façon suivante: «lorsque nos facultés, jeunes, actives, entières, mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet… On habite, avec un cœur plein, un monde vide; et, sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout.»
«Un cœur plein dans un monde vide»… Oui, cette expression décrit bien ce que je ressentais confusément à cette époque charnière de ma vie.
Le vague à l’âme exprimait chez moi la quête d’un but, d’un objectif, que dis-je, d’une cause à défendre! Mais pas n’importe laquelle, semblait-il, puisque rien de ce qui s’offrait à moi n’arrivait à m’enthousiasmer ou à dissiper une certaine langueur.
Il y avait une part d’inconnu dans l’équation de ma vie, que je n'arrivais pas à résoudre.
Or, chaque printemps, quelque chose faisait irruption. Une anomalie singulière survenait dans mon quotidien que je n’aurais voulu manquer pour rien au monde.
Pour commémorer la mort de Jésus sur la croix, le Vendredi saint, on interrompait le programme de télé en cours, à 15h00 pile. Une simple image, une musique méditative, une minute. Je pleurais chaque fois, l’émotion surgissant, immédiate, comme si elle avait toujours été là, à fleur de peau, prête à se déverser.
«Il valait mieux qu’un seul meure plutôt que tout le peuple», avait-on jugé. «UN POUR TOUS».
Devise du Vendredi Saint dont on a peine à mesurer toute «la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Amour qui surpasse toute connaissance!» (Éphésiens 3:18)
Durant cette minute annuelle, je me sentais vivre au diapason d’un évènement, que dis-je, d’un Avènement extraordinaire. Je vibrais intensément. Je ne soupirais plus, j’aspirais!
Mais… Les 60 secondes écoulées, le fil des images à peine interrompu reprenait son cours, comme si de rien n’était. Comme si l’image de Jésus était elle-même dépassée, remplacée par d’autres.
Puis, un jour, alors que j’avais seize ans, un étudiant au Collège m’a invitée à connaître un groupe qui se décrivait comme une société d’évangélisation. Moi-même de confession catholique, j’étais, à ma connaissance, l’une des rares filles de mon âge et de mon entourage qui continuaient à «aller à la messe du dimanche». Pourtant, au contraire de ce qu’on aurait pu penser, j’ai hésité longtemps avant d’accepter son invitation, trouvant toutes sortes de prétextes. Pourquoi?
Je connaissais et voulais vivre l’Évangile, bien sûr, mais je n’évangélisais pas. C’était là toute la différence. Pour évangéliser, il fallait ouvrir une porte, celle qui séparait les deux mondes qui se partageaient ma vie. Il me fallait sortir de chez moi, ce milieu privé où s’exprimait ma foi, pour suivre Jésus sur les routes du monde, ce qui impliquait de confesser aux autres que je mettais ma foi en lui. Et ça, ce n’était pas facile.
Lorsque je me suis décidée à mettre le pied dehors, c’est-à-dire à témoigner de ma foi “publiquement” pour la première fois, je ne m’adressais qu’à une seule personne, une amie de surcroît, et pourtant, je ne sais trop pourquoi, je craignais sa réaction. Je crois même que je tremblais un peu.
Mais le monde n’était plus vide. Ce premier geste accompli, une onde de joie, d’amour même, vint dissiper tout vague à l’âme. Et un courage que je ne me connaissais pas s’est manifesté et se manifeste encore, chaque fois.
Cette confiance que je mettais en Jésus engageait toute mon existence. Ma vie, ou mieux, LA VIE était désormais pleine de sens à découvrir! L’avenir même avait un but.
La fin de la philosophie
Mes études collégiales terminées, je voulais m’inscrire à l’Université, mais aucune discipline ne m’intéressait vraiment. J’aurais pu prendre une année sabbatique ou aller en théologie comme certains me le suggéraient. J’ai finalement choisi de m’inscrire au Département de philosophie, en attendant de trouver quelle était ma voie. J’y suis restée neuf ans.
J’ai longtemps pensé que mon entrée en philosophie était purement circonstancielle, un pis-aller même, qui avait eu pour avantages de me faire obtenir des bourses d’études et de me laisser beaucoup de temps libre pour m’impliquer dans des activités d’évangélisation. Les exigences académiques, du moins à l’époque, n’étaient pas très contraignantes. Mais, d’une session à l’autre, j’allais réaliser à quel point ces paroles de Jésus étaient toujours actuelles:
«Ne pensez pas que je vienne jeter la paix sur la terre. Je ne viens pas jeter la paix, mais l’épée.» (Matthieu 10:34)
Un véritable duel intellectuel était à l’œuvre, dont j’allais faire l’expérience dans mon cheminement philosophique.
Dès mes premiers cours, je me suis aperçue que Jésus faisait problème. Certains de mes professeurs ne manquaient pas de lancer quelques piques à la «religion». Il est vrai qu’il ne faut pas assimiler le Christ aux systèmes idéologiques qu’on identifie au «christianisme». Les excès commis en son nom méritent certainement des critiques.
Cette nuance faite, la personne de Jésus demeure effectivement une pierre d’achoppement pour une certaine manière de «faire» de la philosophie.
La philosophie est pour ainsi dire née quelques centaines d’années avant notre ère, cette naissance correspondant à son inscription dans le temps par l’écriture. Elle a évolué au rythme des différents sages dont on a retenu les noms et les écrits, qui ont fait école et dont les principes alimentent encore les chaires d’universités.
Mais, en un temps qui a marqué notre ère, a surgi Iéshoua, que les chrétiens appellent Jésus le Christ. On devrait pouvoir le considérer au moins comme un sage qui a fait des disciples et même reconnaître qu’il a marqué l’Histoire, mais, pour ceux qui «font» de la philosophie (1), il n’est pas question de parler de sa sagesse. Car «ça», c’est de la religion!
Or Jésus n’appartient pas à une religion. Il appartient intrinsèquement à l’Histoire de l’Humanité, il en marque le point critique pour ainsi dire. Ce n’est pas sans raisons que, dans les contrées où son enseignement a été transmis et suivi, on a voulu calculer les années en termes d’avant et après Jésus-Christ. Dans les autres parties du monde, le calendrier diffère. La France révolutionnaire qui se caractérise par son laïcisme avait même inventé le sien, pour un temps.
J’en suis venue à penser que Jésus marque effectivement la «fin» de la philosophie, dans les deux sens du terme: dans un cheminement philosophique, son enseignement commence là où s’épuisent les efforts des penseurs et il répond à la finalité première de la philosophie: l’amour de la sagesse.
La rencontre de la Sagesse
Habituellement, en philosophie comme en algèbre, pour connaître ce qui est inconnu, on part du connu. Mais s’il s’avère que le point de départ et la finalité de la connaissance sont eux-mêmes inconnus, voire même inconnaissables, qu’arrive-t-il? On aura beau développer les sciences et les techniques jusqu’à gagner les confins de l’univers, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, exploiter jusqu’au centième de notre cerveau, celui-ci sera sans doute comblé de data formidables, mais l’«âme» en sera-t-elle pour autant satisfaite? Aurons-nous trouvé notre raison d’être? Sans cette raison d’être à la base, la quête de la pensée ne peut être rassasiée, à peine satisfaisante. C’est une soif inextinguible.
Les philosophes Présocratiques ont tous éprouvé les limites de la connaissance. Observant la Nature et le comportement des Hommes, ils en tiraient des lois et des leçons, mais ils reconnaissaient, chacun à leur manière, leur ignorance fondamentale en ce qui a trait au pourquoi des choses. Confinés qu’ils étaient aux apparences, la vérité leur échappait. Et ils l’admettaient. Pour eux, l’accès à la vérité et l’accès à la réalité se superposaient. Devant leurs limites, quelques-uns ont choisi de renoncer à découvrir cette part demeurée inconnue parce qu’inaccessible, alors que d’autres ont continué de désirer en pénétrer le mystère.
«Si tu n’espères pas, tu ne rencontreras pas ce qui est scellé et impénétrable», disait Héraclite. Une autre de mes citations favorites.
«Ce qui est scellé et impénétrable». C’est un peu la situation dans laquelle notre connaissance se trouverait s’il n’y avait pas eu le Christ, si la «rencontre» de la Sagesse et de la Vérité n’avait pas eu lieu. Jésus est le seul à avoir dit de lui-même: «Je suis le chemin, la vérité et la vie.» En d’autres mots: «Je suis la Sagesse, je viens vous dire ce qui «est» et qui vous échappe.»
Aucun sage de l’Histoire antique n’a jamais osé dire une telle chose, même que les plus sages d’entre eux ont été très explicites à ce sujet. Socrate, par exemple, ne voulait pas qu’on l’appelle maître, et ce n’était pas seulement parce qu’il ne se faisait pas payer ses leçons. Il disait humblement: «Moi qui ne sais rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais quelque chose.»
Sa méthode d’enseignement allait en ce sens. C’était une forme de maïeutique selon laquelle il s’appliquait à faire «accoucher» les esprits. Il amenait ses interlocuteurs à découvrir, au fur et à mesure de la discussion, leurs contradictions et donc «qu’ils ne connaissaient rien».
Et puis, considérant le fait que les mythologies justifiaient les débordements humains en attribuant aux dieux des mœurs débridées, Socrate pensait que la sagesse ne pouvait se révéler qu’à la raison. Et cette raison lui disait que, logiquement, Dieu devait être le Bien, le Beau, le Vrai, le Juste. Il enseignait déjà, 400 ans avant le Christ, que la véritable sagesse devait résider en Dieu. Il le déduisait rationnellement, mais il n’était pas en mesure de dire qu’il le «savait». Le philosophe ne pouvait aller plus loin sur le chemin de la sagesse. Il était sur le porche de la Révélation.
Sur ce point précis, il me semble que nous sommes tous alignés avec les plus «grands» philosophes. Nous avons des questions essentielles dont nous sommes impuissants à trouver les réponses par nous-mêmes. Et la logique même l’atteste. La vie comporte une part de mystère que nous ne pouvons sonder jusqu'au fond. À moins que quelqu’un qui la connaisse nous en indique le chemin et même nous y précède.
L’acte de foi de la pensée
On a une vision tellement religieuse de la foi au Christ qu’on finit par en perdre le sens. Elle ne s’applique pas à un culte ou à un ensemble de préceptes. La foi, c’est d’abord une rencontre avec Quelqu’un qui suscite en nous une confiance absolue - jusqu’à croire sans voir - et que l’on choisit de suivre. Ce quelqu’un a dit: «Je suis la Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.» (Jean 8:12)
La foi n’est pas un savoir au sens commun du terme, mais elle donne accès à celui qui sait ce que l’on ne pourrait connaître autrement: la foi au Christ me donne une certitude sur le fond et le but des choses.
Cela n’implique pas que Jésus a tout dit, mais qu’il a révélé l’essentiel pour que je prenne le chemin d’espérance.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité… (Jean 1:12-13a)
J’ai donc choisi Jésus comme maître à penser.
De toutes façons, comment orienter sa vie sans recourir à un guide, c’est-à-dire à quelqu’un qui, semble-t-il, en sait plus que nous: des parents, des professeurs, des éminences religieuses, des spécialistes, des gourous, des écrivains, des scientifiques, des personnalités politiques ou culturelles, des animateurs ou promoteurs d’idéologie, écologistes, pacifistes, etc. Dans mon cheminement philosophique, j’ai rencontré des marxistes, des nietzschéens, des thomistes, des tenants du constructivisme ou du déconstructivisme. Et la liste peut s’allonger ainsi, indéfiniment.
Évidemment, on peut aussi essayer de se donner un sens, être son propre maître à penser en vue de se réaliser soi-même. C’est une position qui m’apparaît bien précaire.
Quoiqu’on en dise, l'acte de foi de la pensée n’est pas une démission, elle ne contraint pas, n’éteint pas l’intelligence. Au contraire, elle la dilate, la revivifie sans cesse, en nous mettant à l’école du maître qui se décrit lui-même comme doux et humble de cœur. Avec lui, on découvre bientôt qu’il existe «une savante ignorance» qui nous pousse à rechercher sans cesse, éclairés par l’Esprit consolateur. C’est ce qu’écrivait Augustin à sa consœur Proba:
Il y a donc en nous une sorte de docte ignorance, mais éclairée par l’Esprit de Dieu qui aide notre faiblesse […] inspire le désir d’un bien si grand, encore inconnu mais déjà attendu avec constance. Comment en effet exprimer quand on le désire ce qui nous est inconnu? Et certes si nous l’ignorions entièrement, nous ne le désirerions même pas; et de même si nous le voyions déjà, nous ne le désirerions plus et ne le demanderions pas avec des gémissements. (Liturgie des Heures, Livre 4, Vendredi 29e semaine, Office des lectures)
La philosophie ainsi comprise perd toute aridité et sort de la tautologie, elle se fait dialogue et quête amoureuse de Celui qui connaît le fond de l'être.
Ma Raison d’être
Sur un écriteau, au sommet de la Croix, était inscrit: «Jésus Roi des Juifs!» Le Christ, descendant de David, est effectivement Roi et cela est d’une importance historique capitale, non seulement pour les Juifs mais pour toute l’histoire des peuples.
Il est aussi celui qui ouvre à notre connaissance le sens de l’univers, de notre existence, de l’être de Celui qui est avant et pour tous les siècles. Jésus est celui qui révèle la Trinité et son projet, la dynamique d’amour du Père et du Fils et de l’Esprit en chacun et chacune de nous. Et il est - fait non négligeable - le premier ressuscité d’entre les morts.
On peut certainement passer à côté de cette Révélation, comme de la résurrection de la chair annoncée dans le Christ, et continuer d’explorer le monde en essayant de le penser sur d’autres bases, en se contentant de ce que l’on peut connaître par soi-même ou bien en se confiant à d’autres guides.
Mais «à qui irions-nous?», interrogeaient déjà en leur temps les disciples du Christ.
Le choix d’un maître à penser fait partie du cheminement philosophique. Il oriente et, en ce sens, il définit le but que l’on peut atteindre dans la vie, notre destinée. Nous avons en français une homonymie des plus significatives. La question «Qui suis-je?» peut être comprise comme portant sur ma propre identité: qui je «suis» (du verbe être), mais aussi sur l’identité de la personne que je «suis» (du verbe suivre). Mon cheminement, c’est aussi mon devenir, et ce devenir n'est pas aléatoire: je deviens qui je «suis», dans les deux sens.
Le choix de la voix comme de la voie à suivre est nôtre, il est toujours libre. C’est pourquoi il est si important de ne pas manquer la croisée des chemins. Autrement, on risque de se chercher et rechercher soi-même sans pouvoir jamais se trouver, ou encore s’égarer sur un chemin qui nous est étranger ou néfaste.
Jésus, fils de David, fils de l’Homme et fils de Dieu, se tient précisément en ce lieu, ce milieu de la Croisée.
Ma Raison d'être se fonde sur la Parole de cette Personne concrète, qui est mon roc, elle ne se base pas sur le sable d'une abstraction intellectuelle ou d’une idéologie, bien que celles-ci peuvent rendre compte de certains éléments de vérité utiles.
Et il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. (Matthieu 13:52)
Enfin, il reste encore une question qui se pose à la croisée des chemins, me semble-t-il: Où Jésus me mènera-t-il si je le suis?
La prière avec laquelle Augustin conclut son Traité sur la Trinité me donne un aperçu de la réponse encore à venir:
Quand donc nous serons parvenus jusqu’à toi, ces paroles que nous multiplions sans aboutir cesseront, et tu seras seul à jamais tout en tous; et nous tiendrons sans fin un seul langage, te louant tous ensemble, et unis tous en toi. Seigneur Dieu Un, Dieu Trinité.
«Tous pour un et un pour tous!», s’écriaient d'une seule voix les Mousquetaires du Roi.
«Toi, tout en tous» et «Nous, unis tous en toi», exulte Augustin. Ici, comme toujours, la réalité dépassera la fiction.
«Car Dieu est le plus grand des romanciers,» dixit une sage de mon entourage.
Francine Dupras
(1) Comme je l’ai évoqué dans le chapitre précédent, Paul a fait une tentative apparemment infructueuse auprès des philosophes grecs d’Athènes, qui l’avaient congédié en disant: «Nous t'entendrons là-dessus une autre fois» (Actes des Apôtres 17:32). Cette réplique me rappelle l’expression bien connue: «remettre aux calendes grecques», qui signifie remettre à une date qui n’existe pas.
..
This article is currrently in process of being translated in English. Thank you for your understanding.
....